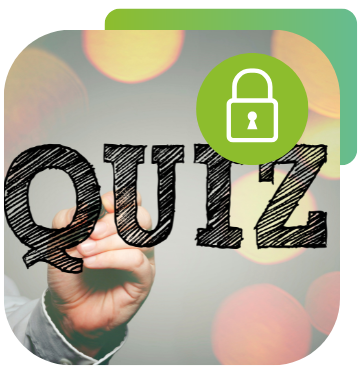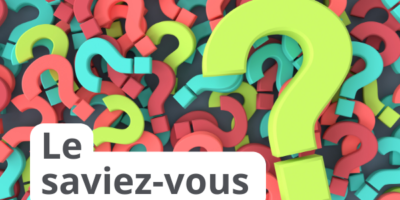LE SAVIEZ-VOUS ?
Quel est le manque à gagner annuel moyen pour une femme âgée de 45 à 60 ans par rapport à un homme du même âge ?
À l’orée de la cinquantaine, un constat s’impose : alors qu’un homme de 45–60 ans consolide son ascension professionnelle, une femme du même âge accumule un manque à gagner moyen de près de 8000 € par an, d’après l’Observatoire de l’émancipation économique des femmes, dans sa dernière note, publiée le 12 juin dernier.
Selon les chiffres publiés par l’Insee pour l’année 2019, les femmes salariées âgées de 40 à 49 ans percevaient un revenu annuel moyen de 22 830 €, tandis que leurs homologues masculins du même groupe d’âge gagnaient en moyenne 29 710 €. L’écart devient encore plus marqué à partir de 55 ans : les femmes touchent alors 21 410 €, contre 29 430 € pour les hommes, ce qui correspond à un différentiel de 27,2 %, contre 23,1 % dans la tranche précédente.
Si l’on projette cette différence sur une période de vingt ans, le manque à gagner cumulé pour une femme atteint 157 245 €, soit environ 7 862 € par an. Dans le secteur privé, à temps de travail égal et en net, l’écart mensuel se creuse avec l’âge : il passe de 421 € entre 40 et 49 ans à 937 € après 60 ans.
Cet écart de rémunération, loin d’être marginal, s’explique par une combinaison de deux formes de discrimination : le sexisme et l’âgisme. Ensemble, ils ont plus de poids aux yeux des employeurs que l’expérience professionnelle ou la maturité.
Bien que l’âgisme affecte aussi les hommes, son impact est plus marqué chez les femmes, car il s’additionne aux inégalités de genre. Près de 17 % des salariées affirment avoir subi une discrimination liée à leur âge, contre 13,8 % chez les hommes. Par ailleurs, 23,7 % des femmes mentionnent avoir été victimes d’inégalités en raison de leur sexe. De plus, 68 % des cabinets de recrutement considèrent l’âge comme un critère potentiellement discriminant, et 47 % reconnaissent rencontrer des difficultés à recruter des femmes de plus de 45 ans.
Le travail à temps partiel constitue l’un des traits les plus marquants de l’emploi des femmes en seconde partie de carrière. En 2017, près de 33,7 % des femmes séniors travaillaient à temps partiel, alors que ce n’était le cas que pour 11 % de leurs homologues masculins. Ce pourcentage grimpe même à 43,3 % chez celles ayant dépassé les 60 ans.
À cette réalité s’ajoutent les interruptions professionnelles – qu’il s’agisse de congés parentaux ou de périodes consacrées à l’accompagnement d’un proche – qui freinent l’accumulation d’expérience et affectent la progression de carrière. Chaque pause dans le parcours professionnel recule la femme dans la hiérarchie des promotions, comme si elle repartait à zéro.
En parallèle, la répartition genrée des métiers, qui perdure tout au long de la vie, contribue elle aussi à l’écart de revenus : les secteurs traditionnellement féminins comme le soin, l’éducation ou les services à la personne restent moins valorisés que ceux comme la finance ou la tech, où la présence des femmes demeure marginale.
À ces facteurs structurels s’ajoutent des charges familiales spécifiques : à cet âge, beaucoup de femmes se retrouvent à la fois grand-mères et filles de parents âgés dépendants. Nombreuses sont celles qui doivent articuler emploi et soutien familial, ce qui peut entraîner une réduction de leur activité professionnelle ou les pousser vers une retraite anticipée.
Enfin, un autre élément encore largement ignoré dans le monde du travail entre en jeu : la ménopause. D’après une étude britannique publiée en mars 2025 sous le nom de The Menopause Penalty, les femmes concernées subissent une baisse de revenus comprise entre 4 % et 10 %, en fonction de la gravité des symptômes rencontrés.
Entre 55 et 69 ans, une part significative de la population se retrouve dans une situation intermédiaire, qualifiée de « zone grise » : ces personnes ne sont ni en activité, ni encore à la retraite — on les appelle les NER (ni en emploi, ni retraités). Trop jeunes pour percevoir leur pension, mais exclues du marché du travail. À 62 ans, les femmes sont presque deux fois plus touchées que les hommes par ce statut précaire : 11 % contre 6 %.
Et lorsqu’elles accèdent enfin à la retraite, l’écart reste criant : les hommes perçoivent en moyenne 2 050 €, contre seulement 1 268 € pour les femmes, soit une différence proche de 40 %, qui prolonge les inégalités de revenus jusque dans la vieillesse.
Dans ce contexte déjà difficile, les séparations — devenues plus fréquentes après 50 ans — aggravent encore la précarité des femmes. La chute du niveau de vie consécutive à une séparation est également très inégalitaire : elle est en moyenne de 22 % pour les femmes, contre seulement 3 % pour les hommes. Les mères, en particulier, sont les plus durement touchées : 34 % d’entre elles basculent dans la pauvreté après une séparation, contre 8 % des pères.
À la une
[QUIZ]
Journée internationale des droits des femmes
Vendredi 7 mars – 9h
[PUBLICATION]
Découvrez notre dossier pratique dédié au mécénat environnemental.
[PUBLICATION]
Découvrez la 6e édition du Panorama 2024 des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes
[QUIZ]
Journée internationale des droits des femmes
Vendredi 7 mars – 9h
[PUBLICATION]
Découvrez notre dossier pratique dédié au mécénat environnemental.
[PUBLICATION]
Découvrez la 6e édition du Panorama 2024 des fondations et fonds de dotation créés par des entreprises mécènes